Hommage à J Chopineau (1936-2015) et extraits des réflexions de J Chopineau sur la lecture biblique
Le 23 juin j'ai reçu un mail d' “Esprit d'avant” me donnant cette nouvelle : «Jacques Chopineau, fondateur de Esprit d'Avant nous a quittés le 10 Décembre 2015. Que sa mémoire soit vive pour tout ce qu'il a été, pour tout ce qu'il nous a donné. Vous trouverez ci-joint quelques écrits signés de ses amis, à sa mémoire : Hommages à Jacques Chopineau 1936-2015 »
J'avais déjà remarqué il y a une douzaine d'années, grâce à ce qui figure de lui sur http://prolib.net/pierre_bailleux/217.bible.htm combien il y avait d'échos avec ce que disait Jean-Marie Martin. Puis j'ai trouvé ses articles dans Jacques Chopineau sur espritdavant en découvrant avec joie que plusieurs auteurs d'Esprit d'avant étaient de fidèles auditrices de J-M Martin : Catherine Luuyt, co-fondatrice d'Esprit d'avant, Sabine Gayet et Cécile du Temple. J'ai déjà mis un extrait de lui à propos du temps des verbes au II de Les verbes en hébreu et le problème de la traduction.
Dans les extraits que j'ai mis ici, il y a beaucoup d'échos par rapport à ce que dit J-M Martin. Je n'en cite qu'un. Lorsque J Chopineau évoque l'eau du rocher au désert (Ex 17,5-7) il remarque : « À ceux qui tentent de sortir de l’esclavage du quotidien, la question est posée de savoir quelle source les alimente. Quel rocher les accompagne ? Non pas seulement: quelle est la ligne de ton horizon ? que places-tu devant toi ? Mais : où puises-tu ton eau ? d’où tires-tu l’eau vive qui te permet d’avancer ? » Comme le dit J-M Martin, c'est la question "Où ?" qui est la bonne question (La question « Où ? » chez Jean. La distinction intelligible/sensible interdit une vraie symbolique).
Christiane Marmèche
- Pour lire, télécharger, imprimer, c'est ici en fichier pdf : Hommage_a_J_Chopineau.
Qui est Jacques Chopineau ?
 Jacques Chopineau a enseigné l'hébreu et la Bible à l'Institut Martin Buber (Université libre de Bruxelles) et à la Faculté de théologie protestante de Bruxelles. Ses années d'études (Montpellier, Genève, Strasbourg, Jérusalem) et de voyages l'ont amené à s'interroger sur ce que signifie aujourd'hui lire la Bible dans les lieux les plus divers de notre monde : « Il est urgent de quitter les discours spécialisés et tenter de dire, en termes intelligibles par tous, pourquoi cette lecture est -en cette époque de fin des temps modernes- une tâche essentielle.»
Jacques Chopineau a enseigné l'hébreu et la Bible à l'Institut Martin Buber (Université libre de Bruxelles) et à la Faculté de théologie protestante de Bruxelles. Ses années d'études (Montpellier, Genève, Strasbourg, Jérusalem) et de voyages l'ont amené à s'interroger sur ce que signifie aujourd'hui lire la Bible dans les lieux les plus divers de notre monde : « Il est urgent de quitter les discours spécialisés et tenter de dire, en termes intelligibles par tous, pourquoi cette lecture est -en cette époque de fin des temps modernes- une tâche essentielle.»
Dans Le promeneur et la boussole -pour un christianisme non dogmatique(1986), il disait :
« Lorsqu'on tente d'enfermer la vérité dans des définitions, cela produit une orthodoxie. Mais pour le disciple, la vérité est une qualité qui ne peut être appréciée qu'en termes de saveur. Toute théorie est grise, comme la vérité devenue orthodoxie. C'est ce que, parfois, on appelle théologie. Mais la sensation est verte, comme la saveur de la qualité. La théologie devient alors une théo-esthésie. Le retour aux sources est un retour au vert »
Hommage à Jacques Chopineau
Cher Jacques.
Tu étais un monde. Un monde de connaissances, de langues et de langages, de signes et de symboles.
Et tu étais un accès à ce monde.
Te perdant, nous perdons cet accès à ce monde, quoique pas vraiment car ce que tu nous as fait entrevoir, ce savoir du fond des âges, ces sagesses anciennes, nous ne pourrons que continuer à les rechercher, à travers les Écritures et tes propres écrits sur Internet ou en livres.
Ce que nous n’entendrons plus, sinon dans notre mémoire, ce sont tes fortes déclamations en hébreu, une langue qui nous dépassait, mais dont la puissante musique nous ébranlait. Et que dire de tes rires et tes jubilations lorsque les textes te livraient des jeux de mots qui nous échappaient quant au sens, mais nous ravissaient quant aux sons... lorsque tu les distillais de toute ta puissance.
Je me souviens aussi de la façon dont tu disais la poésie, qu’elle soit allemande, espagnole, française, arabe... Tellurique était ta voix, quels que soient les mots et les langues, auxquels tu donnais puissance et souffle.
Tu y étais plus à l’aise je crois que dans le quotidien, comme l’Albatros lorsqu’il est condamné à marcher. Et tu étais parfois un peu rude. Deux d’entre nous s’étaient laissées séduire par l’apprentissage de l’hébreu. Lorsque tu nous «corrigeais», de ta voix forte, nous nous demandions si ce verbe n’était pas à entendre dans son double sens.
Érudit et expert de tous les âges de cette langue que, tout jeune, tu avais appris d’abord tout seul, opiniâtrement, tu savais aussi interroger ton temps, la marche de l’Europe notamment, qui te faisait surfer sur le Net –et donner ton analyse.
 Ton regard, fixé au-delà du moment, allait là où nous ne pouvions aller, c’était un peu un regard de prophète, analogue peut-être au regard de ceux que tu aimais et décryptais pour nous, les Isaïe, les Amos, les Jonas.
Ton regard, fixé au-delà du moment, allait là où nous ne pouvions aller, c’était un peu un regard de prophète, analogue peut-être au regard de ceux que tu aimais et décryptais pour nous, les Isaïe, les Amos, les Jonas.
Merci à toi, Jacques, pour tout ce que tu nous as apporté.
Merci à Catherine qui nous a permis de te rencontrer.
Te voilà délivré d’un corps qui t’a fait beaucoup souffrir ces dernières années et je pense que, tel Du Bellay, «...pour t’envoler vers un plus clair séjour/Tu as au dos l’aile bien empennée». Un plus clair séjour où résident la Sagesse, la Justesse, la Justice, l’Amour.
Tu nous quittes mais tu restes avec nous, comme ceux que l’on aime. Je parle au nom de tous ceux que tu sais.
Au revoir, Jacques.
Sabine Gayet
Extraits de ses réflexions sur la lecture de la Bible
Pour avoir accès au texte d'origine cliquer sur les titres colorés
I – Deux extraits d'articles d'Esprit d'avant
Une langue est une manière d’être au monde. Une manière de sentir, de penser, de découper la réalité… Bref, une manière unique de voir ce monde qui nous entoure. Alexandre de Humboldt disait que l’âme d’un peuple vit dans sa langue. Vers la même époque d’ailleurs, un autre penseur (Fichte) affirmait : La langue d’un peuple, c’est son âme. C’est ce que beaucoup, aujourd’hui, semblent avoir oublié.
Comme on sait, une langue ne se réduit pas à un lexique et une grammaire. Une langue est le véhicule d’une sensibilité, d’une vision du monde, d’une manière de penser. Apprendre une langue –après s’être familiarisé avec un vocabulaire et des règles grammaticales- c’est découvrir une autre manière, non seulement de s’exprimer, mais une autre manière d’être au monde.
C’est folie de rêver d’une langue partout diffusée et qui –peu à peu- remplacerait les langues par un idiome unique. Ce serait peut-être propice aux affaires, mais désastreux pour les cultures humaines.
De fait, une langue qui meurt est un appauvrissement de l’humanité : un regard qui disparaît, une oreille qui se ferme. Dans ce cas aussi, nous sommes riches de nos différences. D’ailleurs, langue très diffusée ne signifie pas langue supérieure. Cependant, dans une culture où, souvent, la qualité est mesurée en termes de chiffre des ventes, le nombre des locuteurs fait la vertu de la langue.
Parler mal sa langue revient à déformer sa propre perception du monde ambiant. Les jargons sont de faibles lorgnettes, parfois divertissantes mais toujours déformantes. Tel jargon à la mode est aussi loin d’un corps véritable que l’épouvantail est loin du corps qu’il est censé représenter. Bien des professionnels de la parole (à la radio comme à la télévision) semblent l’avoir oublié…
Une langue est comparable à un corps vivant. Certains mots viennent du cœur, d’autres viennent de la tête ou du ventre… De là, cette ancienne conception de la langue comme un corps formé par tous les mots d’une langue. Dans ce schéma, le Nom divin est perçu comme une couronne à la tête de tous les autres mots (ce nom est d’ailleurs appelé « couronne » en araméen : taga). C’est le nom qui est « au-dessus de tous les noms ».
Une telle conception, si elle n’est pas actuelle dans la forme, n’est cependant pas naïve. La langue structure la pensée. On pense comme on parle. Ce que le philosophe Louis Lavelle exprimait lorsqu’il disait : « Le langage n’est pas comme on le croit souvent le vêtement de la pensée. Il en est le corps véritable ».
[…]
Rappelons la situation pédagogique ancienne. Le maître enseigne et l’élève écoute et « opine » -c’est-à-dire exprime son opinion : ce qu’il comprend, ce qu’il ne comprend pas, ce qu’il accepte ou refuse. À la transmission du savoir, le seul obstacle est le silence de l’élève. Seule la question de l’élève atteste que la transmission est réelle. Cette situation est au point de départ du texte araméen suivant, emprunté au midrache[1] :
« Un élève de Rabbi YoHanan était assis devant ce dernier. Rabbi YoHanan lui donnait une explication, mais lui n’opinait pas. Pourquoi est-ce que tu n’opines pas, demanda Rabbi YoHanan ? Parce que je suis un exilé – D’où es-tu ? – De Borsiph[2]. Il lui dit : ne dis pas cela, mais de « Bolsiph » car (l’Ecriture dit) « Là, l’Eternel « a confondu leur langue » (en hébreu : balal sefatam)»
Le jeu de sonorité est propre à se graver dans la mémoire de l’élève. Le nom du lieu “Borsif” est rapproché du texte biblique étudié : “balal sefatam”. De là, ce mot : “Bolsif”. Finalement, le maître dit : Si tu ne sais pas « opiner », tu seras un étranger partout. Ta terre natale, c’est le texte de l’écriture. Et si tu ne sais pas apprendre à le lire, tu seras un exilé en tous lieux de la terre. Présentement, tu n’es pas de Borsiph (ton lieu de naissance), mais de Bolsiph (lieu de la confusion). Peu importe ton lieu de naissance et ton lieu de vie. Certes, tout homme est né là où sa mère l’a mis au monde. Mais naissance n’est pas accomplissement. Ne pas « opiner » mène à ne pas comprendre et cela conduit à être en exil. Seule la « compréhension » nous fait revenir à la « langue » pré-babélienne. Et cela suppose une relation profonde avec le texte. C’est la parole retrouvée –au-delà des mots, mais grâce à eux…
[…]
Toute langue s’enrichit non seulement de qu’elle nomme, mais aussi de ce qu’elle désigne et qu’elle n’atteint pas encore ! Nous sommes riches aussi de nos aspirations et de nos espérances. La langue nous donne de les nommer.
Jacques Chopineau, Esprit d'avant N°9 Mai 2010
 Comment s'y prendre pour éviter les formulations péremptoires du genre: "Dieu a dit" ou "la Bible dit"… comme si nous étions détenteurs d'une vérité indiscutable, en face de laquelle d'autres approches devraient être écartées. Comme si nous étions dans une situation dont nous seuls aurions la clef. Il me semble que la Bible ne nous permet pas d'extraire des vérités intangibles que nous pourrions opposer à toutes interrogations des hommes de notre temps. La lecture de la Bible n'est pas une discipline scientifique.
Comment s'y prendre pour éviter les formulations péremptoires du genre: "Dieu a dit" ou "la Bible dit"… comme si nous étions détenteurs d'une vérité indiscutable, en face de laquelle d'autres approches devraient être écartées. Comme si nous étions dans une situation dont nous seuls aurions la clef. Il me semble que la Bible ne nous permet pas d'extraire des vérités intangibles que nous pourrions opposer à toutes interrogations des hommes de notre temps. La lecture de la Bible n'est pas une discipline scientifique.
Par contre, la Bible nous invite à lire notre situation au travers un prisme particulier: un texte à la fois fondateur et révélateur de notre situation véritable. Et chaque génération est responsable de sa lecture… dans sa propre situation. Il n'existe pas de lieu théorique de la lecture. Toute lecture est située. Ce n'est pas le texte qui est situé une fois pour toutes et dont une lecture "scientifique" pourrait extraire le sens indépendamment de la question posée! Toute relecture est modelée par la question qui est posée au texte biblique par un lecteur, dans un temps donné.
[…]
● La paix n'est pas l'absence de guerre
Alors que dans notre langage courant, la guerre s'oppose à la paix, il est intéressant de noter que dans le langage biblique le mot traduit par «paix» n'est pas l'exact opposé de la guerre. le mot «shalom» peut signifier la paix, le bonheur, l'harmonie, la santé, etc…
Genèse 26,29: Isaac est renvoyé "sain et sauf" (en paix) et il peut quitter Abimelek et ses gens en bonne harmonie (en paix). Mais être en paix, c'est aussi se bien porter, être en bon état physique (Genèse 29,6; 43,27).
Ces usages sont courants jusqu'en hébreu actuel. Le même mot peut désigner aussi une tout autre paix, celle qui est mentionnée dans les titres du Messie, "le prince de paix" (Esaïe 9,5): «Il y aura une souveraineté étendue et une paix sans fin pour le trône de David et pour sa royauté, qu'il établira et affermira sur le droit et la justice» (Esaïe 9,6).
Remarquons que cette «paix» n'est pas séparée d'une manifestation essentielle: la justice (cf encore Esaïe 32,17; 59,8). Un règne de paix est inconcevable sans un règne de la justice! Ainsi en Jérémie 6,14 le shalom serait le contraire de l'injustice régnante: «On dit paix! paix! et il n'y a pas de paix!» Ce n'est pas la guerre non plus… du moins, pas encore! La catastrophe est proche, mais elle n'est que la conséquence de la conduite des uns et des autres (cfr Jérémie 6,13 ou 8,11). Plus tard, lorsque la déportation aura lieu, Jérémie exhortera les déportés à se soucier désormais de la propérité, du bonheur (la paix) de la ville où ils sont déportés (Jérémie 29,7).
Si la paix (shalom) est associée à la justice, elle est aussi associée à la vérité: «Aimez la vérité et la paix» (Zacharie 8,19 - Esaïe 39,8 - Esther 9,30).
Il arrive aussi, mais rarement que le mot "paix" (shalom) soit pris comme un simple antonyme de "guerre" (1 Rois 2,5 - Qohelet 2,8). Dans l'ensemble cependant, le mot hébreu désigne une manière d'être heureuse, harmonieuse sans quiétude pour le présent ou pour l'avenir. C'est la justice qui élève une nation, qui en assure la paix, disent les Proverbes (Prov. 29,4; 16,12; 20,28; 25,5). Et l'inverse est également vrai: l'injustice détruit une nation! Ce n'est pas là une pétition de principe: sans justice, sans vérité, il n'a jamais existé de paix au sens biblique.
● Le récit symbolique de la première violence.
Les textes appelés "récits des origines" (Genèse 1 à 11) ont une visée particulière dans l'ensemble du Pentateuque: ils donnent le cadre général de l'histoire de l'humanité. Histoire intérieure en même temps que données permanentes. Il s'agit de l'homme en général et non d'un peuple particulier. La lecture de ces textes, placés en tête de l'ensemble des écrits bibliques, nous apprend que tout ce qui existe procède du même Dieu unique et qu'il n'existe qu'un seul genre humain habitant un seul espace humain appelé la terre.
Un seul genre humain. Cela signifie que races et cultures n'ont qu'une existence transitoire liée à l'histoire et à la géographie. En fait, il ne s'agit que de branches plus ou moins bourgeonnantes de la même famille humaine. La seule véritable division de cette humanité est celle qui marque la division des sexes (Genèse 1,27). L'unique genre humain est marqué du chiffre deux: l'humanité est mâle et femelle. Division qui n'est ni liée à l'histoire, ni à la culture. Dire Dieu, c'est dire Un. Dire l'homme c'est dire deux. Toute la réalité humaine est marquée du chiffre deux.
Si tous les hommes sont fils d'Adam, il existe deux manières d'être fils d'Adam. C'est ce que le récit biblique suggère en disant qu'Adam a deux fils: Caïn et Abel. Il y aura de tous les temps, des Caïn et des Abel. L'un ne cessant jamais de tuer l'autre. Les rédacteurs ont placés au cœur du récit des origines, l'histoire de la première violence: le meurtre d'Abel. Et la suite du même chapitre rapporte l'origine de la civilisation. Succession hautement significative…
Les noms des deux enfants qu'Eve met au monde indiquent déjà deux caractères bien différents. Le nom de Caïn (qayin) est mis en relation avec le verbe "qnh" (acquérir), cfr Genèse 4,1. Par un effet de résonnance étymologique, le nom de Caïn évoque l'idée d'acquisition. Au contraire, le nom du second fils Abel (hévèl) signifie proprement: buée, haleine, souffle léger… métaphore habituelle du néant, surtout dans le langage poétique (cfr Psaumes 39,6; 62,10; 144,4). Le nom d'Abel suggère ce qui n'a pas de consistance, ce qui est voué à une disparition prochaine.
La suite du texte va bien dans ce sens: alors qu'Abel meurt sans descendance, tué par son frère (Gen.4,8), Caïn au contraire va être le fondateur de la civilisation. La première ville porte le nom du fils de Caïn (Gen.4,17). Et de la famille de Caïn viennent l'élevage, les arts, le travail des métaux (Gen.4,20-22). Et le texte n'omet pas de souligner que la multiplication de la lignée caïnite est contemporaine d'une multiplication de la violence (Gen.4,24).
D'Abel on ne parle plus. Le frère assassiné a disparu, semble-t-il, pour toujours. De Caïn, au contraire, le monde est rempli. Les villes et les industries vont se multiplier en même temps que la violence va se répandre.
Pourtant, la descendance d'Adam ne s'arrête pas là. Un autre fils, un autre Abel, va être suscité, mis à la place d'Abel (cf le jeu de sonorité sur le nom de "shet" et le participe "shat" = "a placé" au verset 25). Contre toute attente, Abel a une descendance, puisqu'un troisième fils vient prendre sa place. C'est même le seul fils qui soit cité dans la liste des patriarches en Gen.5,3: «Adam vécu 130 ans, à sa ressemblance et selon son image il engendra un fils, et il l'appela Seth»
L'histoire d'Adam du chapitre 5 se poursuit en Seth et Enosh, le premier a invoquer le nom de Dieu (Gen.4,26). N'est citée dans la descendance d'Adam (le genre humain) que la lignée de Seth, laquelle aboutira à Noé (Gen.5,29 sq.). Cette lignée seulement traversera le déluge… De Caïn et de toutes les œuvres caïnites, il ne restera rien.
L'histoire écrite de cette manière est hautement symbolique. D'une part, toute civilisation est caïnite et toute civilisation est fondée sur la violence. D'autre part, ce qui est construit de cette manière n'est pas appelé à durer. Ne traversent le déluge que les huit personnes dans l'arche (1 Pierre 2,5), c'est-à-dire Noé et les siens. Ces huit personnes, image du huitième jour, symbolisent le monde nouveau, après la mort de l'ancien monde (2 Pierre 2,5).
C'est donc finalement Abel l'assassiné qui, à travers la descendance du fils suscité à sa place (Seth), est à l'origine du monde nouveau. L'histoire d'Adam se poursuit en Abel et Noé. Le Nouveau Testament nous invite à revenir sur la signification de cette figure d'Abel, l'assassiné.
● La foi d'Abel
Abel, le premier tué, est compté parmi les prophètes dans cette parole de Jésus: «… Afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui a péri entre l'autel et le sanctuaire…» (Luc 11,50 sq; Matt.23,35).
Dans ce texte, Abel et Zacharie représentent le premier et le dernier d'une longue liste de prophètes tués, pendant toute la durée de l'histoire de l'ancien Israël. C'est en raccourci la totalité des tués qui est invoquée: le premier de ces tués étant Abel. On peut se demander en quel sens Abel peut être cité au nombre des prophètes, lui dont nous n'avons aucune parole et à peine l'évocation de sa courte vie… Mais cette question peut être éclairée par une autre parole que nous lisons dans l'épitre aux Hébreux sur ce verset, non expliqué, de la Genèse. En quoi le sacrifice d'Abel peut-il plaire à Dieu ?…
«Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il reçut le témoignage qu'il était juste et Dieu rendit témoignage à ses dons. Grâce à elle, bien que mort, il parle encore» (Hébreux 11,4).
Ce "il parle encore" nous renvoie au texte de la Genèse (Gen.4,10) où il nous est dit que «le sang d'Abel crie du sol» vers Dieu. Qu'as-tu fait de ton frère? est-il demandé à Caïn. Et la question ne cesse d'être posée à cause de tous les Abels assassinés depuis la fondation du monde. Depuis que la civilisation et la violence caïnite ont commencé de régner sur le monde.
Deux manières d'être fils d'Adam avons-nous rappelé plus haut. Mais la partie caïnite de l'unique humanité de Dieu est en même temps celle qui domine. Abel est le nom des dominés, des écrasés, des assassinés: la plus grande partie de l'humanité. Or, il faut se souvenir que cette partie de l'humanité qui traverse le déluge est celle d'Abel, à travers la postérité de Seth. Si le sort du monde dépendait de Caïn, il y aurait lieu d'être, comme on dit, pessimiste! Mais, contre toute attente, Dieu donne une postérité à Abel que Caïn avait tué (Gen.4,25). C'est la postérité d'Abel qui porte l'espérance et non les réalisations de la civilisation de Caïn. Il en va de même aujourd'hui: l'espérance de l'humanité est portée par les pauvres. L'espérance est portée par ces masses immenses et croissantes des pauvres. Et certes, la pauvreté, au sens biblique, désigne d'abord un état de faiblesse et pas seulement un statut économique.
Ces textes nous disent finalement deux choses:
- Ce monde est dominé par la violence et il est illusoire de penser qu'il en ira autrement dans l'avenir…
- Cette situation ne serait tragique que si l'homme était le véritable maître de notre monde: s'il était livré à son propre génie…
Mais en même temps, même Caïn est protégé des plus graves débordements: Dieu ne le met pas à mort et même il met un signe sur lui pour que personne ne le frappe (Gen.4.15). Caïn est appelé à la repentance.
[…]
Jacques Chopineau, Ad veritatem, 1984/2
II – Extraits du site prolib.net
1) Oecuménisme VS communautarisme ?
L'œcuménisme serait-il en panne ? Ou bien deux conceptions s'opposent-elles : œcuménisme de rassemblement ou de respect des différences ?
Cela fait des siècles que les chrétiens disputent du message chrétien. Nous sommes aujourd'hui bien loin de la grande diversité doctrinale des commencements du christianisme. À moins d'être spécialiste, nous avons même oublié cette diversité -dont témoignent des textes peu connus, des évangiles « apocryphes », des écrits polémiques divers. Depuis le quatrième siècle, le poids des « vérités » dogmatiques n'a cessé d'augmenter.
On sait que l'enseignement de Jésus Christ a précédé largement tout discours dogmatique et que l'obéissance à Jésus va devant l'obéissance au pape ou à un quelconque magistère. Ce que Jésus disait et ce que l'église a dit : est-ce la même chose ? Oui, à en croire les théologiens de telle église ; non, à en croire d'autres théologiens. La « vérité » est un sujet de discussions.
Les racines sont anciennes. Le christianisme, dès le quatrième siècle, a écarté, voire éliminé durement, tout ce qui s'opposait au pouvoir de la « grande Eglise », celle du grand empire romain. Le saint magistère a élaboré, au fil du temps, un formidable édifice dogmatique qui est aujourd'hui devenu une barrière à la diffusion de ce christianisme. Il faut revenir aux origines.
[…]
La Réforme du XVIe siècle a été en son temps une tentative pour revenir aux origines, en écartant bien des pesanteurs inutiles. Cette remise à jour conduisait à une rupture de ce qui était encore l'unique institution de salut du monde occidental.
La rupture d'avec l'Église d'orient est antérieure (1054 et, surtout, le pillage de Constantinople par les croisés en 1204). Mais avec la Réforme, c'est l'occident lui-même qui est divisé. L'accord d'Augsbourg (1555) consacre pour des siècles une séparation « religieuse » entre, en gros, le nord et le sud de l'Europe occidentale.
Un principe de la Réforme était que l'Ecriture seule est source de vérité (Sola Scriptura). Ni pape, ni tradition, ni magistère humain… ne peuvent lui être opposés. Ce principe était alors révolutionnaire.
Mais depuis lors ? En fait, ni Trinité, ni « deux natures », ni « sainte mère de Dieu », ne figurent dans les Écritures. Le malheur de la Réforme est qu'après avoir proclamé, en ce temps-là, des choses justes : elle a ensuite répété les mêmes vérités sans en adapter les termes ; comme si une formulation était intemporelle. La vérité était, semble-t-il, dans les mots qui la définissaient. Encore les réformateurs ne connaissaient-ils ni l'infaillibilité pontificale, ni l'Immaculée Conception, ni l'Assomption de Marie…
Pour autant, les définitions diverses ne sont pas, en soi, des obstacles. Dans la mesure, du moins, où les tenants de ces « vérités » respectent ceux qui n'ont pas la même approche. Est-on moins frère parce que l'on pense différemment, ou qu'on le dit en d'autres termes ?
Si tel enseignement fait partie de la démarche chrétienne, tout chrétien se doit de la respecter. L'œcuménisme se situe à un autre niveau : celui du vivre ensemble. Et de chercher, dans toutes les situations ce qui est la volonté de Dieu ou, ce qui revient au même, ce qui donne de faire un pas de plus sur le chemin de la compréhension, de la justice, de la tolérance, du respect de l'autre en ce qu'il est.
Ce qui constitue, par contre, un obstacle c'est le caractère imposé de telle formulation canonique, à l'exclusion de toutes les autres. C'est alors seulement que la fraternité est rendue impossible, brisée par les intransigeances doctrinales. C'est de là que nous venons.
Ce qui est sûr, c'est que si le christianisme ne réforme pas son langage, les églises (toutes les églises) continueront de se vider. Il ne s'agit donc pas d'une « mise au goût du jour », mais d'une réforme en profondeur. Revenir aux sources ; reprendre à frais nouveaux ces vieux débats dont on a cru être débarrassé par des mesures autoritaires.
On n'envisage pas ici, évidemment, une sorte de syncrétisme doctrinal, mais le respect des différences, ces différences qui ne sont plus, répétons-le, des « divisions », engendreuses d'exclusions.
[…]
L'œcuménisme nouveau se situe à un tout autre niveau. Au plan des personnes, et non au plan dogmatique ou institutionnel. La doctrine n'est pas la foi. Il y a bien une manière catholique de marcher vers le christianisme. Mais il y a aussi une manière orthodoxe, une manière luthérienne ou réformée ou anglicane etc… En l'occurrence, l'essentiel n'est pas de savoir d'où nous venons, mais où nous allons. La même source a donné naissance à plusieurs torrents, lesquels se rejoindront dans la grande plaine où vivent tous les hommes. Le chemin du respect des différences est sans doute encore long, mais il n'en existe pas d'autre.
Cela n'empêchera pas tel groupe dit « œcuménique » (surtout jeune) d'apprendre à se connaître, à vivre ensemble une expérience nouvelle, à servir…. Pour autant, les traditions différentes, comme des langues sont différentes, ne seront pas effacées.
Toutes les options dogmatiques sont relatives, liées qu'elles sont à l'histoire de leur surgissement. Et il ne s'agit pas ici de « communion au rabais », comme certains le disent, pas plus qu'il n'est question de « brader » l'essentiel pour trouver un accord minimum. Ce serait là une piètre conception de l'œcuménisme, pire encore qu'un « retour au bercail ». Il s'agit de faire droit, en les respectant, aux différences.
Le monde dans lequel nous vivons amène même à se demander si cette « ouverture au monde » ne pourrait pas être étendue à d'autres « croyants » musulmans ou juifs.
Et -dans un autre moment, peut-être- cette ouverture devrait sans doute s'étendre aussi à toutes les personnes sincères, soucieuses de justice et de vérité. Même si elles ne se réclament pas d'une tradition religieuse.
Bien sûr ce nouvel œcuménisme prendra du temps pour commencer réellement, sur une grande échelle (des groupes actuels montrent la voie, mais ils sont encore rares).
Le premier pas serait d'accueillir fraternellement la nombreuse communauté musulmane de nos pays. Non pour en faire des chrétiens, évidemment, mais pour partager, pour rencontrer, pour connaître… d'autres approches, d'autres manières d'être.
Le respect de l'autre, dans sa différence, est le premier pas de la tolérance. Dans la société qui se construit, il s'agit là d'une nécessité proprement incontournable. Saurons-nous faire ces pas ? Le feu (du futur) couve sous les cendres, mais les cendres (du passé) risquent toujours de l'étouffer.
[…]
Jacques Chopineau, Genappe, 15 janvier 2004
2) Lire la Bible, Ed. de l'Alliance, Lillois, 1993[3]
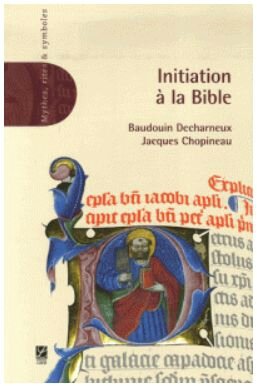 a) Histoire et parole (p.18-20).
a) Histoire et parole (p.18-20).
Pour raconter les événements antérieurs à ceux qui ont lieu aujourd’hui, la langue biblique utilise un mot étonnant (davar) qui signifie tantôt «parole» et tantôt «chose». Cela ne signifie pas qu’en hébreu, le mot soit la chose même, comme l’ont cru (ou feint de le croire) quelques exégètes égarés dans la métaphysique.
Les hébreux, gens concrets, sont des nominalistes[4] à l’état natif. L’image est reine : l’image verbale, non l’image taillée laquelle en devenant fixe a perdu son pouvoir d’aimantation. L’image taillée, comme l’idée fixe, appartient aux horreurs de la pensée religieuse monothéiste.
Une formule très courante du récit biblique est: «Il arriva après ces événements (choses, paroles...)». C’est une manière habituelle de commencer le nouveau récit qui fait suite à celui que l’on vient d’entendre. Mais ces «choses», c’est la narration même qui les fait arriver… pour l’auditeur. La récitation (la re-récitation) seule anime les «événements».
Ainsi seulement, les événements prennent vie en «paroles». Des événements mis en forme de parole. Car un événement ancien n’a lieu que dans les paroles qui le rapportent. Là où le texte seul existait, la lecture fait retentir une «parole».
C’est ainsi que la parole donne à l’événement sa réalité pour les générations à venir. Et ce que nous appelons des «chroniques» des temps anciens (cf. les livres bibliques dits: «chroniques») s’appelle en hébreu les «paroles des jours», c’est à dire d’abord les paroles qui donnent sens à ce passé dont nous sommes les héritiers. Notre histoire est tournée vers le passé mais les histoires bibliques sont tournées vers l’avenir.
Il en va de même aussi de ces «histoires» (anecdotes, paraboles, hadith...) qui ont, dans les anciennes traditions religieuses, une fonction essentielle d’enseignement.
b) Un texte démontable ? (p. 24-25)
Osons un paradoxe apparent : le sens du texte n’est pas dans le texte. Comme dans la fable du trésor caché dans le champ, il n’y a pas de «trésor» dans le champ. Mais il n’y a pas non plus de trésor en dehors du champ. Où donc est le trésor ? Il est dans le travail accompli pour retourner le champ et l’ensemencer. C’est alors que le champ se met à produire!
Le sens du texte n’est pas dans le texte, mais dans la lecture du texte. Or, il ne saurait y avoir de lecture sans lecteur. Cela nous avertit d’emblée contre toutes les «méthodes» qui se donneraient pour tâche de tirer du texte un sens «objectif» ou encore (langage plus moderne) de «démonter le texte pour voir comment il fonctionne». Un texte ne «fonctionne» pas : la lecture le fait fonctionner. Il ne produit pas de sens, mais la lecture, seule, du texte «produit du sens». Et sans lecteur : y aurait-il encore une lecture ?
À quoi la chose est-elle semblable ?
C’est l’histoire de l’escalier qui produisait de l’élévation. On s’avisa de démonter l’escalier pour voir comment il fonctionnait et, du coup, il n’y avait plus d’escalier! En réalité, l’escalier ne produit rien. Simplement, par lui, je puis monter ou descendre. Et je ne vais surtout pas le démonter pour voir comment il fonctionne! Car, comment lire un texte démonté ? De fait, si je démonte le texte, je ne pourrai «lire» que mon démontage, c’est à dire, en fin de compte, que ce que j’ai dans l’esprit. Mais celui dont l’esprit est organisé autrement lira tout autre chose! Il est dès lors arbitraire de penser, d’une manière ou d’une autre, pouvoir extraire le sens du texte indépendamment de la lecture qui en est faite.
Par contre, nous y reviendrons, le lecteur est «situé» historiquement, culturellement, religieusement. C’est cette «situation» qui est le contexte de la lecture. Et la lecture de la Bible comme Bible n’est pas simplement l’étude d’un corpus documentaire. L’étude dépend évidemment de la connaissance des derniers travaux sur le texte, mais ce n’est pas la Bible «Parole de Dieu» qui est l’objet d’enquêtes philologiques.
On dit souvent que la lecture de la Bible nourrit la foi du lecteur. Bien sûr, mais il est vrai aussi que c’est que cette foi qui nourrit la lecture: à chaque «foi» correspond un certain type de lecture. Dis-moi quelle est ta foi, je te dirai quelle est ta lecture, savante ou non. Plutôt que le contraire.
Afin de restituer au lecteur sa lecture, le premier pas est de reconnaître au lecteur la part de son propre travail sur le texte biblique : avec ses propres connaissances, ses propres interrogations, ses propres limites. Pour l’essentiel, presque rien de son propre travail ne peut être remplacé par le travail d’un autre. De même que celui qui doit travailler son propre champ ne peut se prévaloir du travail accompli, même avec des moyens impressionnants, dans le champ voisin.
Ainsi, les études peuvent informer, éclairer, enrichir ma lecture, mais rien ne pourra jamais la remplacer finalement.
c) La colombe avalée (p. 28-29)
Un sujet bien rarement abordé doit ici être évoqué à l’aide de quelques exemples : la relation entre la lecture du texte et les études sur le texte. Toute lecture, comme toute théologie, s’élabore à partir de questions. Toutes mes lectures s’ordonnent à partir de ma question, autour d’elle. Je suis le champ sur lequel tombe la pluie. Il n’est qu’une seule sorte de pluie, mais tous les champs sont configurés d’une manière différente.
Il existe toute une littérature savante qui tente de déterminer l’espèce de monstre qui a avalé Jonas (baleine ? squale ?). Faute de pouvoir prendre l’histoire au pied de la lettre, il fallait trouver une explication rationnelle propre à expliquer l’origine de la légende. Sur quel noyau historique primitif l’affabulation a pu se construire. L’ingéniosité des savants nous paraît aujourd’hui confondante. La «baleine» a été remplacée par un navire au nom de “la baleine” ou d’une auberge-refuge à l’enseigne de “la baleine”. Tout cela dans des ouvrages savants écrits en latin et, plus tard, en allemand. Jonas, même, n’aurait-il pas trouvé refuge sur une épave qui était le corps d’un grand poisson mort?
Toutes ces thèses ont réellement été soutenues! La bibliographie est considérable, surtout du dix-neuvième siècle à nos jours. Ce serait un long exposé que de décrire seulement les diverses hypothèses présentées. Dans tous les cas, beaucoup de science a été utilisée pour trouver de possibles parallèles dans les langues anciennes et les «sources» anciennes. Naturellement, l’érudition philologique peut satisfaire un public intéressé à l’histoire des mots ou des formes, l’histoire des civilisations anciennes. De ce point de vue, le livret de Jonas ouvre matière à un long exercice.
Certes, les études actuelles ne reprennent pas toutes ces hypothèses : le «grand poisson» est une figure d’une autre sorte. Signe et symbole, non espèce zoologique… Mais le sort des hypothèses est d’être remplacées par d’autres hypothèses lorsque les précédentes ont cessé de paraître pertinentes. D’ailleurs, le fait de ne plus trouver de point d’application sur tel sujet «dépassé» n’interdit pas d’appliquer la même méthode sur tel autre point pour lequel il existe encore de la bibliographie récente.
C’est le cas, par exemple, pour l’espèce botanique du fameux «kikayon» (Jonas 4,6). Comme dans le cas de l’espèce zoologique du «grand poisson», toute une littérature a tenté de définir l’espèce botanique de la plante miraculeuse qui abritait le prophète contre l’ardeur du soleil (lierre, courge, coloquinte ?). Nos traductions modernes restituent habituellement ce mot étrange par «ricin», parfois (plus prudemment) par «arbrisseau» ou «plante». Plus rarement, une simple transcription veut rendre le terme en Français : «kikayone» ou «qiqayon». «Et l’Éternel manda un kikayon qui monta au-dessus de Jonas pour être une ombre sur sa tête et le protéger de son mal. Et Jonas se réjouit au sujet du kikayon, d’une grande joie. Mais Dieu manda un ver, à la montée de l’aurore, le lendemain, et il frappa le kikayon qui se dessécha» (15).
Cependant, toutes ces précisions au sujet de l’espèce botanique sont oiseuses. Gageons qu’aucune espèce botanique jamais n’a produit une plante susceptible d’engendrer, en une nuit, des feuilles capables de protéger un homme contre l’ardeur du soleil. Et peu importe qu’il s’agisse, dans le texte, d’un baobab ou d’un légume! Ou que «baobab» ou «légume» se dise comme ceci ou comme cela en Égyptien ou en Akkadien ou en toute autre langue ancienne.
Pour le lecteur, le miracle est le même, parce que, dans tous les cas, l’espèce botanique n’existe pas. Comme le notait (au XIIe siècle) le grand commentateur judéo-espagnol Ibn Ezra: «Il n’est pas nécessaire de savoir ce que c’est». Plus intéressant serait de savoir pourquoi c’est ce mot-là qui est choisi; pourquoi dans cette forme-là ? Pourquoi jamais ailleurs dans la Bible ? Et surtout: quelle fonction ce mot étrange peut avoir dans le texte actuel du livret ? Autrement dit: quelle est la saveur particulière de ce terme dans le cadre du livret de Jonas ? Et la recherche de la saveur du texte nous mène sur des pistes nouvelles. C’est alors, dans un nouveau cadre, que le mot pourrait prendre un étonnant pouvoir d’évocation.
d) L'humanité sexuée (p. 32-36)
«Mâle et femelle, Il les créa» (Gn 1, 27). Il est impossible de penser la réalité humaine en dehors de cette évidence fondamentale : l’humain est marqué du chiffre deux. Les «races» n’existent pas : il n’est qu’une seule race humaine. En termes bibliques, tous les humains sont fils d’Adam. Par contre, il y a deux manières d’être fils d’Adam : une manière mâle et une manière femelle. «Adam» signifie «genre humain» : un nom collectif pour la réalité humaine totale, mâle ou femelle.
La réalité humaine est sexuée. Tout n’est pas sexuel, certes, mais tout est sexué. Il serait vain d’ignorer cette réalité comme il serait vain de la lier à des notions étrangères ici comme celle de mal, de péché ou de culpabilité. Il est vrai que nous ne sommes pas sortis de ce dernier amalgame. Mais si la réalité humaine est marquée du chiffre deux, cela ne s’applique pas seulement à la division sexuelle. D’abord parce que si le mâle domine en l’homme, cela ne signifie pas qu’il n’y ait rien en lui de femelle. Naturellement, l’inverse pour la femme est vrai aussi. Et non seulement cela, mais Caïn et Abel sont vivants en chacun de nous. Et tout ce que l’homme-Adam fait, pense, entreprend… est marqué par cette dualité fondamentale (bien-mal, noir-blanc, juste-injuste, oui-non, vrai-faux, etc.).
Et la suite du texte de la Genèse m’apprend encore autre chose : il y a deux manières d’être «fils d’Adam». L’une s’appelle «Caïn», l’autre s’appelle «Abel». Depuis les origines, l’un tue l’autre et, jusqu’à nos jours, Caïn n’en finit pas de tuer Abel. Aussi longtemps qu’il y aura des fils d’Adam, les fils de Caïn tueront les fils d’Abel. Les frères ennemis ne se réconcilieront jamais. L’un d’ailleurs n’est pas plus le bien que l’autre n’est le mal. Simplement, la fin du chapitre 4 m’apprend que le frère tué sera remplacé par une nouvelle descendance : «Adam connut encore sa femme qui eut un fils auquel elle donna le nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m’a accordé une postérité pour remplacer Abel que Caïn a tué» (Gn 4, 25). Et lisant la suite du texte avec attention, j’apprends que seule la descendance de Seth (Noé et les siens), contre toute attente, traversera le déluge !
Quelle que soit l’origine de ces textes, il est impossible que cette mise en forme des textes soit fortuite: les scribes qui ont transmis ces textes dans cet ordre-là portent un jugement sur la réalité. Faire l’histoire de la formation du texte ne répond pas à la question : ce texte-là, dans cette forme-là, a-t-il aujourd’hui quelque chose à m’enseigner ? Est-il possible de faire abstraction de la forme actuelle du texte ?
Prenant le texte dans sa forme actuelle, je suis armé pour m’opposer à tous les racismes comme à toutes les exclusions fondées sur le sexe. Mais dans le même temps, je me prends à douter de tous ces discours, sans doute généreux, qui parlent d’une réconciliation entre Caïn et Abel. La guerre (armée ou non) fait partie de la réalité de ce monde. Les conflits sont inscrits dans la réalité humaine, tout autant que la division de l’humanité dans les deux sexes qui la constituent.
Certes, ma lecture ne sera jamais la seule lecture possible : d’autres liront autrement la réponse à leur question. D’autres étayeront autrement leur lecture de leur réalité. Le problème n’est pas d’arriver à un illusoire consensus (dogmatique, politique, philosophique, exégétique), mais d’éclairer ma propre vision: voir et donner à voir.
Dans tous les cas, les études préliminaires indispensables ne constitueront jamais ma lecture. Pas plus que la saveur d’un plat ne peut être indiquée en termes de protéines, glucides, lipides! La comparaison n’est pas fortuite: le sens d’un texte se trouve exactement dans la saveur que ma lecture y découvre.
e) La diversité des textes (p. 20-24)
Toute l’histoire biblique (mise en forme pour être racontée) est accrochée à ce que nous nommons «mythe». À l’inverse, une idée «biblique» (un extrait sec dont la matière première serait le récit biblique) voudrait que l’on discerne un «sens» des événements derrière les événements de l’histoire.
C’est ainsi qu’on fait de la «théologie biblique». Mais il est toujours périlleux d’extraire le sens après dessiccation[5] de la chair du récit. La simple re-récitation de ces récits bibliques donne mieux à entendre ce que les rédacteurs y voyaient. Eux, ils voyaient du point de vue d’une communauté présente et future. Mais hors communauté, le danger est grand de faire de la théologie «in vitro» et de ne voir dans les histoires racontées que de l’histoire (passée) intelligible.
Au contraire, les anciens ont utilisé une manière (plutôt qu’une «méthode»), aujourd’hui bien décriée, qui est une lecture dite «typologique» et dont le N T offre plusieurs exemples.
Un éminent critique littéraire[6] a bien vu cette construction biblique de l’histoire où les événements s’emboîtent de telle manière qu’un événement ancien est le «type» d’un événement actuel ou futur. Nous avons là un moyen de nous y reconnaître dans le foisonnement des événements de l’histoire, une possibilité de déchiffrer des répétitions qui échappent à la causalité simple. La grande courbe en U est un utile support de compréhension :
Quatre grands moments dont les deux extrémités sont au plus haut, tandis que les deux intermédiaires sont au plus bas. Tel est le schéma intérieur de toutes ces histoires de descentes et de remontées qui foisonnent dans la Bible, ces chutes suivies d’un rétablissement après un temps d’épreuve, ces tribulations dont la fin est un statut nouveau, meilleur encore que le premier. C’est Job frappé et rétabli; c’est Jonas remonté du fond des mers; Joseph sorti de la fosse, puis de la prison.
C’est aussi le peuple tiré de la servitude de l’Égypte ou l’Israël ramené de la captivité. Et c’est aussi le chemin de cette humanité appelée à un avenir qui est un Retour, non un retour en arrière mais une remontée selon la deuxième branche du grand U. C’est à cette perspective que se réfère le Nouveau Testament en faisant du Christ le nouvel Adam. La mise en forme du passé procède ainsi d’une vision de l’avenir. En fait, elle n’est que cela. La mise en forme est visionnaire parce qu’elle est destinée à être un support de compréhension, et non d’abord une histoire à prendre au pied de la lettre.
Le danger d’une certaine typologie a été de perdre de vue l’enracinement charnel des protagonistes et/ou des événements, ne voyant que des «types» généraux et abstraits dans les récits. Un autre danger a consisté à ne voir dans les événements que ce qui pouvait «préfigurer» ce que la doctrine allait dire. Dès lors, on ne pouvait plus «lire» dans le texte que ce que la doctrine en disait.
Mais ces dangers font largement partie de l’histoire ancienne. Plus actuel serait qu’au terme d’une analyse savante, on ne voit plus dans ces textes que ce qui est conforme au fonctionnement de notre pensée. La «réalité» n’étant alors qu’une structure générale et abstraite. Seule une réalité structurée par le langage peut être appréhendée par la pensée et se couler dans le moule du langage discursif. Pourtant, une réalité non structurée, vague et mal pensée, forme la matière de la plus grande partie de notre vie. Et si la vie n’est pas entièrement rationnelle : comment la lecture le serait-elle?
C’est ainsi que le lecteur est poussé à chercher dans le texte de la Bible un éclairage vital. La lecture, ce n’est que cela…
f) Ce sens qui est saveur (p. 36-39)
C’est le même mot en hébreu ancien : Le mot «taam» signifie à la fois «goût», «saveur» et «sens». Dire d’une chose qu’elle n’a pas de saveur, signifie qu’elle n’a pas de sens. Un texte sans saveur est dépourvu de sens. Le sens est ainsi un écho de saveur, un prolongement de la lecture. Il ne s’agit donc pas simplement d’étudier un texte, mais d’entendre une parole. Or, il n’est pas de «méthode» propre à capturer la parole ; il n’est pas de filet pour la capter. L’écoute seule peut la capter, comme on dit qu’une source est captée, lorsqu’on a réussi à la faire dériver vers les assoiffés.
Après quelques siècles d’ignorance (voire de mépris), voici qu’on s’intéresse à nouveau à cette ancienne manière juive d’aborder les textes bibliques : le «midrache». En fait, il ne s’agit ni d’un genre littéraire unique, ni d’une «méthode» unique. C’est dire que le « midrache » résiste aux définitions qu’on voudrait en donner. Sans entrer ici dans beaucoup de détails techniques, relevons que dans tous les cas le «midrache» suppose, d’une part, une étude attentive du texte de l’Écriture et, d’autre part, l’existence d’une communauté consciente de sa réalité et de son avenir. Comme chez les Pères de l’église, tout passage de l’Écriture peut être éclairé par un autre passage de l’Écriture. Mais dans le midrache, la diversité des opinions exprimées n’utilise ni recours à un magistère central, ni anathème porté contre celui qui lirait autrement.
Le principal ressort de l’enseignement du midrache est ce que nous nommons : la parabole. Le mot “parabole” (en latin «parabola») est un doublet du mot «parole». Une parabole est une parole. Ainsi sont aussi les paraboles de l’Évangile. Mais au contraire de tant de discours savants où la précision du langage cache parfois le flou de la pensée, la parabole ambiguë est le fruit d’une pensée claire. La parole d’enseignement procède d’un sage. La mise en parabole, ne peut être que le fait d’un sage qui sait exactement ce qu’il veut enseigner. Les paraboles cependant prennent pour nous la forme d’un texte écrit. Et sur ce texte (son origine, sa forme, l’histoire de sa transmission) peut s’exercer la science philologique. Les paraboles sont pour nous le texte des paraboles. La parole est devenue un texte!
C’est l’occasion de rappeler que dans la langue hébraïque ancienne (la langue de la Bible), il n’est pas de mot pour dire «texte». La langue moderne utilise le calque gréco-latin «tekst». La Bible cependant, dans la tradition juive, est appelée couramment «miqra’», c’est à dire «lecture» ou «lecture à haute voix». Un «texte» n’est pas une «parole» mais, par la lecture à haute voix, le texte devient parole. A l’inverse, notre mot «texte» est une ancienne métaphore. C’est le calque francisé de «textus»: participe passé du verbe latin «texere» (tisser). Et le «tiste» de l’ancien français (re-latinisé à partir de «textus») a donné en français moderne le mot «texte», lequel signifie d’abord «tissé-tissu».
Les métaphores ne sont pas innocentes. Parler (si parler exprime la pensée), revient toujours à comparer ceci et cela. Un «texte-tissu» (trame et chaîne) peut toujours être découpé, analysé. Un tel texte-tissu existe par lui-même : indépendamment de la lecture qui en est faite. On peut donc l’étudier pour lui-même, historiquement, philosophiquement, théologiquement. De même, un corps mort existe tout autant qu’un corps vivant. Et d’ailleurs, si l’on vise l’analyse des composants, mieux vaut n’avoir pas étudié un corps vivant! C’est ce que Goethe (par la bouche de Mephisto) disait de la chimie de son temps[7] :
« Celui qui veut connaître et décrire le vivant
cherche d’abord à en ôter la vie :
Il a dès lors toutes les parties en main
mais il manque, hélas, le lien spirituel »
De même, un texte non-lu existe tout autant qu’un texte lu. Mais la lecture est la vie du texte. Le lecteur est celui qui, dans le tissu du texte, découvre peu à peu les chemins qui ont de la saveur. Le «sens» est alors la saveur découverte. Le sens ne peut pas être séparé du bonheur de lire. Si c’est de Bible que nous parlons, nous dirons que la parole est toujours et seulement le fruit d’une écoute. Les mots d’un texte ne deviennent «parole» que par un processus d’appropriation dont le premier temps est l’écoute.
À quoi la chose est-elle semblable ?
Paraphrasant une ancienne parabole juive, je comparerai cette écoute à la pluie : toutes les pluies sont une. Mais tombant sur le figuier, la pluie produit des figues; tombant sur la vigne, la pluie produit du raisin; tombant sur l’olivier, la pluie produit des olives… De même, la parole biblique, sur les uns produit ceci, sur les autres produit cela. Une même pluie produit infiniment des fruits différents.
g) Le Psaume 136 (p. 42-48)
... L’Écriture se relit elle-même. Chaque texte peut ainsi être lu «en écho» à d’autres textes des Écritures. Cela est vrai en particulier pour ces textes du psautier : La piété des psalmistes est nourrie des Écritures. L’auteur anonyme est un d’entre ces lévites qui ne font que continuer un héritage. Ce sont des transmetteurs qui transmettent ce qu’ils ont eux-mêmes reçu. Leur part personnelle n’est pas le plus important.
Tels sont les deux versants de ce que l’on nomme la tradition : on ne reçoit que par sa propre écoute, mais on ne transmet que par l’écoute de ceux à qui on s’adresse. Encore faut-il trouver les formes propres à transmettre la saveur des chemins d’autrefois. D’autant que les chemins d’autrefois ne sont pas toujours reconnaissables aujourd’hui. C’est ici qu’intervient la part du transmetteur: faire reconnaître aujourd’hui les chemins d’autrefois, les chemins par lesquels pourra se former en nous une image de notre présent et de notre futur. Rien n’est transmis que dans une forme : tout doit prendre forme. Dans la langue des psaumes, les diverses formes de la louange sont le canal de la transmission.
Le texte du psaume fait écho à d’autres textes des Écritures. Des textes bien connus des scribes (auteurs et transmetteurs) et des fidèles. Ainsi, le thème de la création, ceux de la sortie d’Égypte, de la conquête de la terre… Intéressants aussi sont les thèmes qui ne sont pas évoqués: l’alliance du Sinaï, la Loi mosaïque, l’élection de David… Cela nous pose la question de savoir qui écrit ainsi, à cette époque-là...
[…]
Toute lecture est une «relecture», c’est à dire une lecture en situation. Simplement, cette situation est la mienne et non celle des lévites de l’époque du deuxième Temple. Une lecture actuelle est une lecture contextuelle : ce «contexte» étant celui du lecteur.
Il ne saurait être question de tenter de dire ce que «l’homme moderne» devrait entendre : il ne «doit» rien entendre, sinon cela même qu’il entend. Et il n’appartient à personne de lui indiquer ce qu’il devrait entendre (du point de vue de l’histoire ou d’une «vérité» dogmatique, politique, théologique ou philosophique). Ma lecture est ma liberté, c’est à dire ma responsabilité. Cela n’a rien à voir avec un individualisme forcené : rien ni personne, ni aucun magistère, ne peut me libérer de ma propre responsabilité. Certes, ma lecture peut être éclairée, enrichie, complétée... mais elle ne peut pas être remplacée. Après un temps plus ou moins long d’information, il me faudra entendre par moi-même ce que le texte me dit. Et ce qu’il me dit a toutes chances de parler à un grand nombre de mes contemporains.
h) L'eau du rocher (p. 48-50)
Pas d’étude «scientifique» qui ne définisse son champ d’études. Le champ des études historique est le passé. L’abondance de la documentation contraint d’ailleurs les historiens à diviser le champ en un grand nombre de parcelles : Il y a autant de spécialités que de périodes et, parfois, autant d’approches que de spécialistes. Mais dans tous les cas, le champ étudié appartient au passé. Mais il n’est pas de science de la lecture parce que la lecture n’est pas un champ d’études. Le texte parfois, non la lecture. Et de même qu’il n’y a pas de lecture sans lecteur, il n’y a pas de sens sans quête de sens, sans attente, sans désir.
La lecture n’est pas un champ d’études parce qu’elle n’existe pas «en soi». Elle est toujours le fait du lecteur. Comme le remarquait un grand connaisseur des lectures anciennes en milieu judéo-palestinien, “un texte n'est pas une chose en soi ni pour soi. C’est un réceptacle de possibilités»[8]. Et la lecture est tournée vers l’avenir, non vers le passé. On peut bien faire l’histoire des lectures passées, mais non indiquer «scientifiquement» les lectures possibles, sauf à considérer (par impossible) tous les lecteurs possibles… Il va de soi qu’une lecture s’inscrit dans des contextes culturels, religieux, individuels particuliers. Toute lecture est contextuelle. Faire droit à la lecture signifie : faire droit à la situation propre du lecteur.
À quoi la chose est-elle semblable ?
Le rocher les suivait, «... et tous burent le même breuvage spirituel ; car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait : ce rocher, c’était le Christ». (1 Cor 10/4) L’apôtre Paul commente ici le fameux passage du Livre de l’Exode où Moïse frappe le rocher de son bâton en faisant jaillir de l’eau, afin de donner à boire au peuple (Ex 17/5-7). Il suit une vieille tradition de lecture du texte de l’Exode.
Nécessairement le rocher les suivait, puisqu’ils devaient boire tous les jours, et tout au long de leur marche de 40 ans dans le désert. Cela ne fait problème que pour ceux qui voudraient prendre le texte au pied de la lettre. Ou bien pour ceux qui voudraient remplacer la lecture du texte par une étude historique, en utilisant «la méthode de la grande ceinture». Ou bien encore en cherchant «comment le texte produit du sens» sans le lire comme il me parle. Il est autant de manières de lire que ne pas lire…
Un tel rocher ambulant ne porte l’eau qu’à ceux qui sont en chemin. Pour qui s’arrête, l’eau est tarie. Car celui s’arrête, s’éloigne toujours plus d’une source en mouvement. La religion, dit un sage, est «une route vers Dieu : une route n’est pas une maison». Le peuple voit la nuée devant lui (Nb 9/22; 10/11) tandis que le rocher, la source, le suit. Images symboliques d’une longue marche vers la liberté.
 À ceux qui tentent de sortir de l’esclavage du quotidien, la question est posée de savoir quelle source les alimente. Quel rocher les accompagne ? Non pas seulement: quelle la ligne de ton horizon ? que places-tu devant toi ? Mais : où puises-tu ton eau ? d’où tires-tu l’eau vive qui te permet d’avancer ? Pour reprendre les termes de l’apôtre Paul : quel est ton «breuvage spirituel» ?
À ceux qui tentent de sortir de l’esclavage du quotidien, la question est posée de savoir quelle source les alimente. Quel rocher les accompagne ? Non pas seulement: quelle la ligne de ton horizon ? que places-tu devant toi ? Mais : où puises-tu ton eau ? d’où tires-tu l’eau vive qui te permet d’avancer ? Pour reprendre les termes de l’apôtre Paul : quel est ton «breuvage spirituel» ?
Le chemin est long et parfois difficile. Mais le «sens» d’un chemin, c’est le lieu où il mène. La raison d’une route, c’est le but qui est le sien. Et lorsque le chemin devient obscur, logiquement incertain, indistinct pour le regard de la pensée claire, c’est alors qu’il doit retrouver la question : quel est le rocher qui me suit et dont je tire, dans mon désert, l’eau vive qui me donnera de faire un pas nouveau ?
Une telle lecture ne suppose aucune «méthode» particulière (mais n’en exclut aucune). Dans tous les cas, rien ne peut remplacer la lecture personnelle du texte «dans son état actuel». «Tout scribe instruit du Royaume des cieux est comparable un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux» (Mt 13/52). Le lecteur est ce «scribe du royaume» : il tire de son trésor (qui est l’Écriture), selon ses besoins, l’ancien et le nouveau.
[1] Voir note précédente.
[2] C’est Borsippa de nos cartes – dans la région de Babylone. Il faut se souvenir que le terrible exil de -587 a été à l’origine d’une importante diaspora juive en Babylonie.
[3] Extraits tirés de http://prolib.net/pierre_bailleux/217.bible.htm.
[4] Nominalisme : doctrine selon laquelle les idées générales ne sont que des mots.ndlr.
[5] Dessication : action de déssécher.ndlr
[6] N. Fry, Le grand Code, la Bible et la littérature, Seuil, Paris, 1984
[7] Gœthe, Faust, I, vers 1936 à 1939
[8] Marcel Jousse, La manducation de la parole, Paris, 1975






/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F20%2F95%2F1166526%2F130963247_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F09%2F21%2F1166526%2F129095142_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F76%2F11%2F1166526%2F127984536_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F66%2F39%2F1166526%2F127709497_o.jpg)